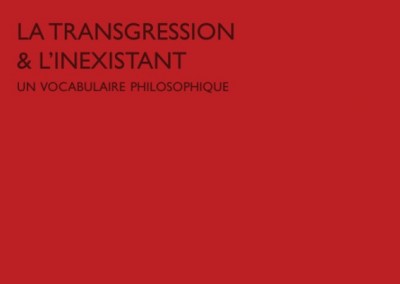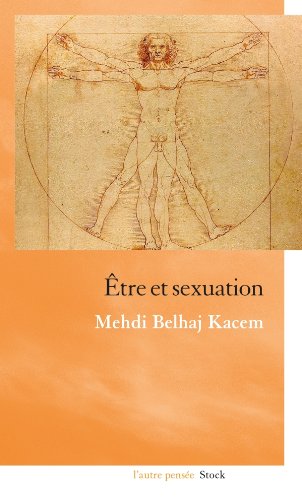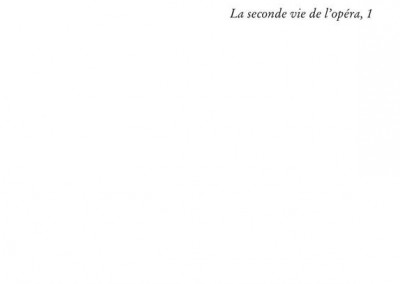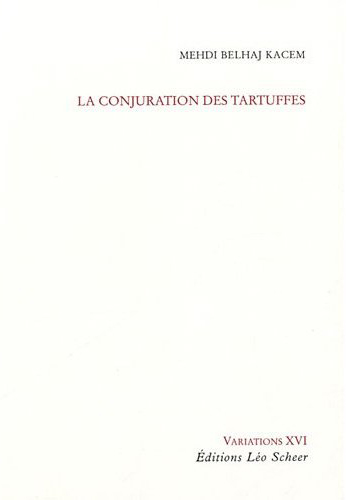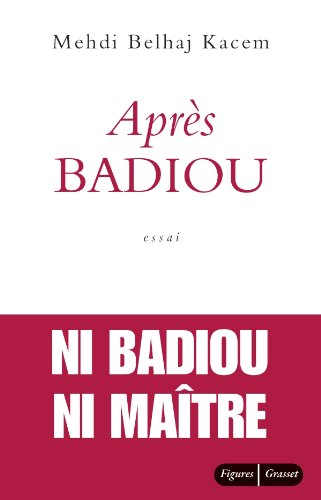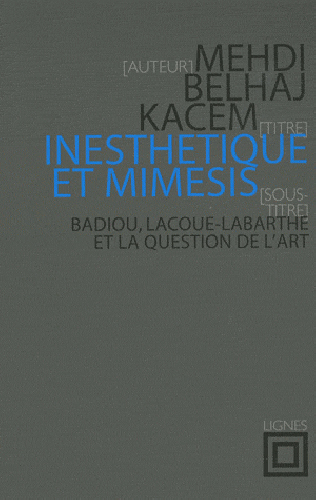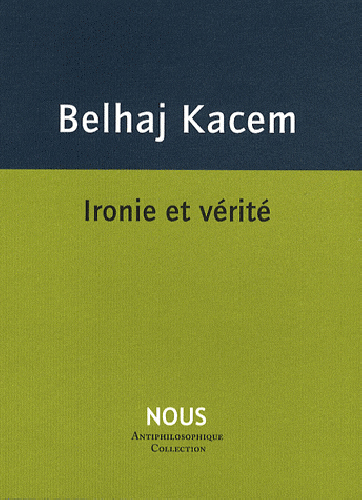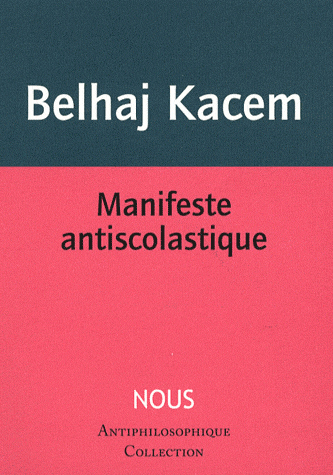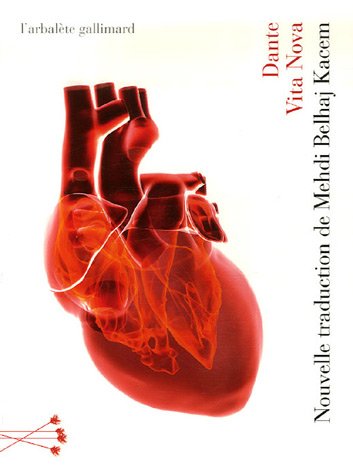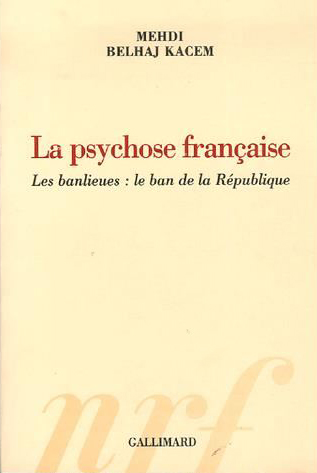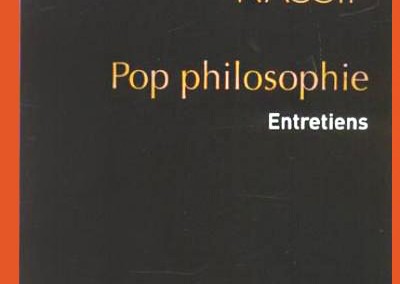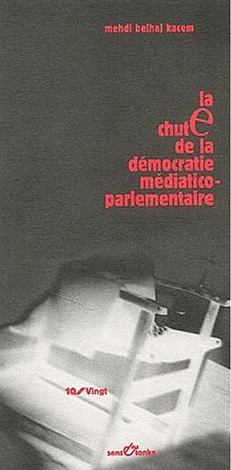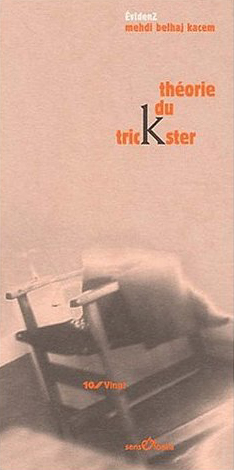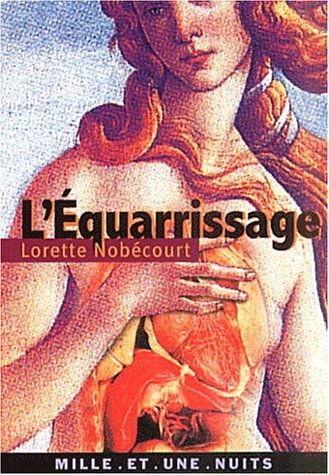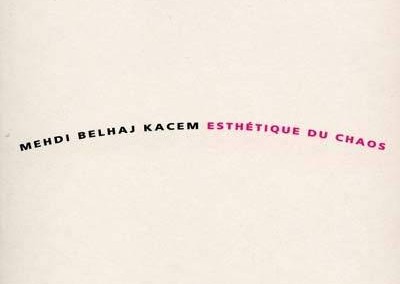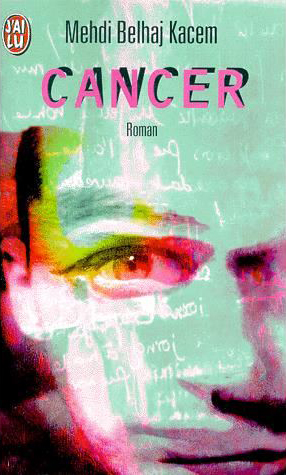C’est dans le soir tombant sur la cité éternelle, quelque part en terrasse aux abords des berges du Tibre, que Mehdi Belhaj Kacem, romancier, philosophe et essayiste, nous a ouvert la porte sur ses lectures. Alors au travail à la Villa Médicis pour une nouvelle traduction des Triomphes de Pétrarque, il nous dit son rapport aux livres, aux mots et aux phrases, en nous donnant à entendre d’un parcours qui a fait de lui l’un des écrivains les plus marquants et les plus protéiformes de sa génération.
Propos recueillis par Romuald Giulivo
Alors que tu as passé ton enfance en Tunisie, dans quelle langue s’est faite ton entrée dans la lecture ?
Medhi Belhaj Kacem : Par le français, indéniablement. J’ai beau réfléchir, je n’ai pas de francs souvenirs de lecture en arabe. J’ai pourtant d’abord tout appris dans cette langue, puisque j’ai fréquenté le lycée ministériel tunisien jusqu’à huit ans. Mais à la maison, bien que vivant dans une famille biculturelle, on parlait essentiellement français. Et du coup, je suis entré dans la lecture de façon assez ordinaire, je crois, pour quelqu’un de ma génération. Pour moi, les livres, ça a été d’abord les bandes dessinées. Les classiques franco-belges comme Tintin, Thorgal, Spirou ou Gaston. Pourtant, si je relis régulièrement le travail de Franquin, que je considère comme un génie de premier plan, je ne suis plus trop ce qui se fait désormais dans le monde de la bande dessinée. Je sais toutefois qu’il s’y passe des choses importantes, qu’il s’y invente de nouvelles formes, de nouveaux enjeux – j’ai par exemple été très touché par L’Arabe du futur de Riad Sattouf, où j’ai reconnu beaucoup de mon enfance.
Après ça, au lycée français, il y a eu mon envie de faire du jeu de rôle, (Donjons et Dragons, L’Appel de Cthulhu, etc.) qui m’a amené vers d’autres univers, ceux de Tolkien, de Lovecraft ou la science-fiction. Sûrement Lovecraft a-t-il été ma première passion littéraire. Et puis il y a ce jour, vers mes douze ans, où ma mère – je me demande encore quelle mouche a bien pu la piquer pour avoir une telle idée – m’a offert Les Chants de Maldoror. Et là, évidemment, ça a été le vrai début de tout. Cela a de plus correspondu, je pense, avec mon retour à Paris – j’y suis né, mais en suis parti à l’âge de six mois – et aussi la pleine entrée dans l’adolescence, la découverte d’une musique sombre (The Cure, Joy division, etc.) et d’un cinéma en marge (Tarkovski, les premiers Lars von Trier, mais aussi pas mal de films gore.) Soit au final un ensemble d’influences et d’intérêts assez cohérent, une préoccupation très précoce pour le Mal, qui deviendra plus tard un de mes sujets en philosophie, pas du tout pour prolonger l’adolescence, mais plutôt pour la résoudre, pour en sortir.
Ton travail d’écriture a toujours fait se croiser roman et philosophie. Mais qu’en est-il de tes lectures ?
M.B.K. : La lecture de la philosophie est arrivée plus tard. Par le biais de Debord et des situationnistes, mais aussi, justement, d’auteurs comme Bataille ou Blanchot qui avaient un pied dans la littérature et un autre dans la philosophie. De toute façon, pour moi, la philosophie est un genre littéraire. La littérature, c’est tout ce qui s’écrit. La poésie, le roman, le théâtre, mais aussi la philosophie – quoi que puissent en dire les universitaires. Je n’ai en fait jamais établi un fossé entre les deux, tant dans mes lectures que dans mon écriture. Je me souviens à mes débuts, Jean-Hubert Gaillot, mon éditeur chez Tristram, m’avait fait une remarque très simple, mais que j’aimais bien. Il m’a dit : « Toi, tu penses par phrases. » Bref, tout ça, c’est avant tout de l’écriture. Il suffit de regarder le nombre de non-philosophes que les textes de Nietzsche – comme Ecce Homo par exemple – ont touché, renversé.
On n’est plus de toute façon à une époque comme celle de Blanchot, où l’on pouvait délimiter ce qu’il appelait un espace littéraire. Il sort trop de choses pour ranger, trier, catégoriser. Au final, mes lectures s’orientent selon d’autres considérations, des prémonitions. Aujourd’hui notamment, j’ai l’impression que quelque chose se joue dans les littératures de l’Est. Je pense par exemple à Kraznahorkai, au Vilnius poker de Ricardas Gavelis. Même Steve Tesisch, dont le Karoo est sûrement un des plus grands romans américains publiés ces dernières années, il est en fait né en Serbie.
Alors que tu as réfléchi et pratiqué, notamment à travers des revues, une certaine forme de communauté d’écriture, comment penses-tu que l’on puisse envisager aujourd’hui de partager la lecture ?
M.B.K. : Les aventures Evidenz, et un peu plus tard Tiqqun, m’ont surtout attiré en réaction à mon parcours. Je venais à l’époque de publier L’Antéforme, dont l’écriture éprouvante et solitaire m’avait donné envie d’autre chose. Je ne voulais pas devenir un écrivain misanthrope, demeurant seul dans sa caverne. J’ai eu besoin alors de rencontrer des gens, de faire et de vivre des choses à plusieurs. La philosophie était un prétexte parfait – ou peut-être devrais-je dire plus modestement la théorie, car je voulais juste au départ devenir théoricien, essayiste, comme Debord, Baudrillard ou le Artaud du Théâtre et son double, c’est ensuite seulement que je me suis pris au jeu de la philosophie. Cette période a été intense et très enrichissante, même si, bien sûr, comme toujours avec ce genre d’expériences, cela s’est plutôt mal terminé.
Après, concernant le partage de la lecture, c’est difficile de répondre, car j’ai longtemps détesté lire mes textes en public. Cependant, la pratique de la philosophie, à travers les conférences essentiellement, m’a permis d’apprendre à surmonter cette incapacité quasi pathologique. Je n’ai toutefois pas de soucis pour lire les autres. J’aimerais bien notamment profiter de mon séjour à Rome pour monter une lecture bilingue à partir de ma traduction de La Vita nova. Je suis fasciné par ce texte, sa première phrase me revient souvent. Comme plein d’autres débuts d’ailleurs, alors que bizarrement ce souci de l’incipit n’est pas présent dans mon travail d’écriture. Je me souviens du début des Chants de Malodor, celui des Confessions de Rousseau, du Panégyrique de Debord, du Journal du voleur de Genet, qui a d’ailleurs donné celui de Rose Poussière de Jean-Jacques Schuhl – livre que j’ai acheté à une époque par piles pour l’offrir à mes amis. Mais le début de Vita nova… « En cette partie du livre de ma mémoire, avant quoi peu se pourrait lire, se trouve une rubrique, laquelle dit ceci : incipit vita nova. » Écrire quelque chose comme ça au XIIIe siècle, c’est époustouflant…
Romancier, essayiste et philosophe franco-tunisien, Mehdi Belhaj Kacem est l’auteur de plusieurs romans parus chez Tristram (Cancer, 1993, Vies et morts d’Irène Lepic…), ainsi que de nombreux essais dont L’Esprit du nihilisme (Fayard), Après Badiou (Grasset) ou Être et Sexuation (Stock).
Bibliographie sélective de Medhi BELHAJ KACEM :
L’Antéforme, Tristram
L’essence n de l’amour, Tristram
Artaud et la Théorie du complot, Tristram
Pour en savoir plus :
Extrait d’un cycle de conférences données à La Générale, Paris