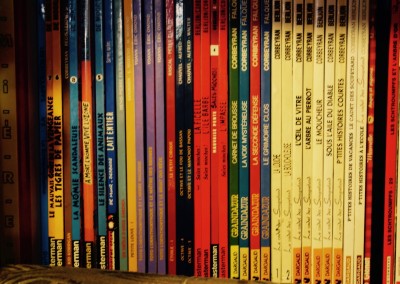En plus de son talent, sa plume alerte et son dessin au style vif, expressif, Richard Guérineau possède une bonne humeur débordante. C’est chez lui, entre deux allers-retours aux ateliers Flambant Neuf qu’il partage avec les dessinateurs Alfred et Régis Lejonc, qu’il nous reçoit pour nous inoculer son virus pour les livres et le dessin.
Propos recueillis par Romuald Giulivo
Qu’est-ce qui est venu en premier dans ta vie de lecteur : l’image ou le texte ?
Richard Guérineau : En réfléchissant aussi loin que mes souvenirs me portent, je dirais que les deux sont arrivés en même temps. Et par la bande dessinée, sûrement parce qu’il n’y a pas de hasard. Enfant, je forçais tous les soirs mon père à me lire les mêmes albums de Lucky Luke. Je ne savais pas encore déchiffrer, j’étais avant tout concentré sur l’image, mais si par malheur il sautait plusieurs bulles pour s’épargner, je le sentais et le rappelais à l’ordre. C’est vraiment la conjonction des deux, texte et images, qui m’a très tôt fasciné. La façon dont les cases s’enchaînent pour raconter une histoire, le mystère de ce mode de lecture au final très complexe qu’est celui de la BD, faisant appel à un dialogue entre les mots et les dessins. J’ai d’ailleurs très vite commencé à copier des planches pour tenter de comprendre comment ça fonctionnait et je l’ai fait jusqu’à mon bac, jusqu’à ce que j’entame des études d’arts plastiques – domaine où la bande dessinée est au mieux vue avec beaucoup de condescendance et au pire complètement dénigrée.
C’était quoi la bande dessinée que l’on pouvait lire lorsque tu étais jeune ?
Richard Guérineau : Dans mon cas, c’était surtout les grands classiques. Tout simplement parce que c’était ce que l’on trouvait au rayon BD du supermarché où je passais mon temps pendant que mes parents faisaient les courses. Gamin, j’étais complètement fan de Blueberry. Plus généralement, j’étais à fond dans le western. J’en regardais chaque mardi à la télé avec mon père, et je dévorais toutes les séries du genre : Blueberry donc, mais aussi Cartland, Mac Coy, etc. J’ai eu une longue période monomaniaque, j’étais fasciné par l’imagerie du western au sens large : non seulement les objets — les selles, les chapeaux, les pistolets, etc. —, mais aussi les couleurs, les lumières qui lui sont propres.
La prose est arrivée plus tard ?
Richard Guérineau : J’ai eu évidemment quelques passages obligés étant enfant, j’ai lu Le Club des cinq ou d’autres tomes de La Bibliothèque verte, mais on ne peut pas dire que ces livres m’aient laissé de grands souvenirs. Je suis réellement tombé en littérature à l’adolescence par le biais du genre. J’ai dévoré Lovecraft, j’ai dévoré Tolkien et aussi pas mal de polars. Je continue d’ailleurs à lire du genre aujourd’hui, mais je n’y suis pas enfermé, je peux me faire plaisir tant avec un bouquin de science-fiction qu’un bon roman intimiste. Je fonctionne le plus souvent par période. Si je découvre un auteur dont un titre me met une claque, je veux ensuite aller explorer le reste de travail et je peux ne plus en sortir pendant des mois, tant que je n’ai pas lu la quasi-totalité de son œuvre. Ça m’a fait ça avec Ellroy, avec McCarthy. Je suis très attiré par les pavés de 800 pages, dont la lecture vous aspire et qu’on retrouve chaque jour, chaque soir avec impatience. Je suis aussi un peu un teigneux, j’aime quand il faut s’accrocher. Étant un grand fan d’Alan Moore, j’ai par exemple lu les 1300 pages de Jérusalem sans en sauter une seule. Le livre est très complexe, certains chapitres sont écrits dans une langue presque phonétique, mais j’ai fourni l’effort et me suis laissé embarqué. Ça ne vaut pas les meilleures BD dont il a signé le scénario — From Hell bien sûr, ou encore Promethea que je tiens pour l’un de ses chefs-d’œuvre —, mais c’était un chouette voyage.
Toi qui as notamment adapté des romans, quel regard portes-tu sur les liens entre littérature et bande dessinée ?
Richard Guérineau : On essaie toujours de ramener la BD soit vers la littérature soit vers le cinéma, plutôt que lui donner un statut spécifique, celui d’une narration faite en même temps de mots et d’images. Nous avons en France une tradition culturelle encore très littéraire — beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons. L’écriture en prose est chez nous sacralisée, quand la bande dessinée demeure — malgré ou peut-être à cause de son succès — cantonnée dans le domaine du divertissement. J’ai donc du mal avec cette question. Toutefois, force m’est de constater que, en vieillissant, je suis de plus en plus attiré dans mes lectures ou dans mon travail par une BD que l’on pourrait qualifier de plus littéraire, même si je n’aime pas ce mot. J’ai envie de sortir du format classique 46 pages, j’ai l’impression d’en avoir fait le tour et préfère des livres plus amples, des univers plus développés et où je peux m’immerger — en gros ce que l’on nomme aujourd’hui des romans graphiques même si, là aussi, je ne suis pas fan du terme.
Quand je fais des albums comme Charly 9 ou Henriquet, je réponds à des envies plus littéraires. Mais je demeure très attentif à un écueil dangereux en BD, celui de devenir verbeux. On parlait d’Alan Moore tout à l’heure et, sur cette question, son travail demeure pour moi une référence : à quelques exceptions près, il a su produire des ouvrages très écrits, mais avec le bon dosage entre mots et images.
J’ai l’impression d’être à une période de mon travail d’auteur où j’ai enfin digéré mes influences. Je cherche par la lecture des surprises dans d’autres univers, d’autres approches qui viendront peut-être alimenter mes futurs albums. Je dis peut-être, car je veille toujours à rester dans la position du lecteur, plutôt que celle qui consisterait à décortiquer toutes les œuvres qui nous passent entre les mains. Quelque part, le plaisir de lecteur importe avant tout le reste.
Richard Guérineau vit dessin et écriture, quelque part à la frontière bordelaise.
Bibliographie sélective de Richard Guérineau :
Henriquet, l’homme reine, éditions Delcourt
Charly 9, (d’après le roman de Jean Teulé), éditions Delcourt
Après la nuit, (scénario : Henri Meunier), éditions Delcourt
Le chant des Stryges, (scénario : Éric Corbeyran), éditions Delcourt
Pour en savoir plus :