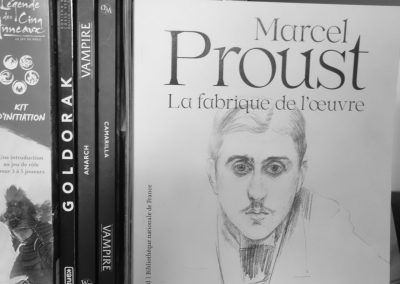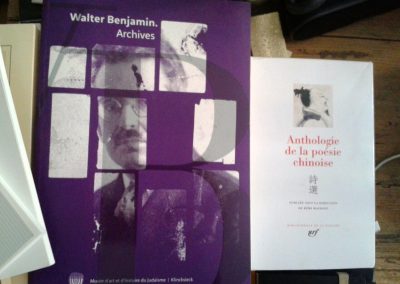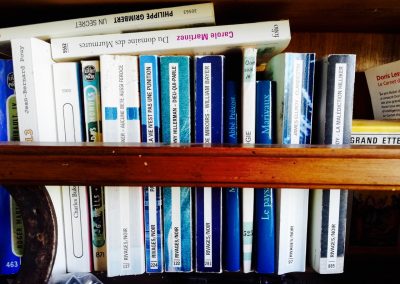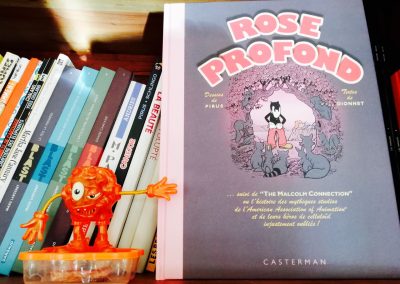Romuald Giulivo
Le 20 octobre 2020, je rencontrais Romuald Giulivo, afin qu’il me parle de son lien à la littérature et à la lecture. Notre première rencontre avait eu lieu en 2002, alors qu’il venait de publier son premier livre et de s’installer à Bordeaux après avoir quitté Paris et son métier d’ingénieur en architecture navale. Dix-huit années se sont écoulées depuis. Dix-huit années à suivre ce chemin choisi parsemé de livres, les siens et ceux des autres.
Propos recueillis par Lucie Braud
Comment définis-tu le terme de lecteur ?
Romuald Giulivo : La lecture est pour moi très proche de la pratique artistique. Pessoa dit dans Le Livre de l’intranquillité que « l’art est la preuve que la vie ne suffit pas. » On pourrait très bien inclure la lecture dans cette formule. Un lecteur est aussi quelqu’un à qui la vie ne suffit pas, quelqu’un qui va chercher une autre forme de narration que celle de l’existence. C’est en tout cas comme ça que je vois et vis les choses. La fiction et la réalité sont mes deux jambes. J’ai besoin de romanesque au quotidien pour vivre bien.
À quel moment as-tu eu conscience d’être un lecteur ?
Romuald Giulivo : Je ne me souviens pas de mon enfance, comme si j’étais réellement né à l’adolescence. C’est à cet âge assez tardif que j’ai découvert des auteurs qui m’ont parlé, m’ont donné l’impression d’avoir écrit certains de leurs ouvrages rien que pour moi. Ça a d’abord été toute une frange de la littérature d’imaginaire, essentiellement fantastique, que j’ai découverte comme beaucoup de gens de ma génération en même temps que la pratique du jeu de rôle. Lovecraft, Robert Howard ou Arthur Machen m’ont ensuite mené vers Poe, Barbey d’Aurevilly ou Lautréamont, vers tous ces auteurs d’un romantisme décadent par lesquels je suis entré dans la littérature. Et une fois devenu lecteur, impossible de faire marche arrière. Les livres sont devenus vitaux, au même titre que la nourriture que je mangeais, l’air que je respirais ou l’eau que je buvais. Par la suite, le cinéma français des années 80 qui était diffusé par Canal+ et qui était un peu dans mon univers familial la seule porte sur le monde, m’a fait découvrir une autre littérature, notamment grâce l’adaptation de 37,2 ° le matin par Jean-Jacques Beineix. Le roman de Djian m’a conduit vers Hemingway, Brautignan, Faulkner, Carver… c’est-à-dire tout ce monde de la littérature nord-américaine à laquelle mon travail d’écriture doit énormément.
Comment tes lectures ont-elles évolué par la suite ?
Romuald Giulivo : Cela fait bien longtemps que je ne lis plus de romans de genre, et je fréquente beaucoup moins la littérature française contemporaine, à laquelle j’ai longtemps été très attaché. J’ai l’impression que mon temps de lecture s’est beaucoup réduit. Du coup, je réfléchis toujours un bon moment avant de me lancer dans un roman. Et mes choix se portent désormais sur des textes qui résistent, qui portent une voix. En ce moment, ce sont ceux de Thomas Bernhard ou de Dostoïevski et, pour parler d’auteurs français du moment, des gens comme Tanguy Viel, Yannick Haenel, Jérôme Ferrari.
Qu’attends-tu de la littérature ?
Romuald Giulivo : J’attends qu’elle donne un sens. Pas forcément à la réalité, mais à un truc auquel se raccrocher. J’aime qu’un livre, en plus de me faire ressentir, me propose une grille de lecture du monde. Qu’il me donne l’impression que tout ce bordel a un sens et que l’on a raison d’espérer. Et puis j’attends aussi qu’il m’offre de la beauté, c’est crucial. Si j’ai longtemps lu plus jeune tout ce qui me passait entre les mains, sans forcément me soucier du style, cela m’est aujourd’hui impossible. Je n’arrive plus à lire un livre quand l’écriture ne me sied pas. Je cherche avant tout des auteurs qui font acte de littérature, qui font entendre une voix singulière. À quoi ça sert sinon de couper tous ces arbres ?
Comment tes lectures influent-elles sur ton écriture ?
Romuald Giulivo : J’aime les livres qui font ressentir. En lisant Moby Dick par exemple, je perçois le goût du sel sur mes lèvres, je devine le vent dans mes cheveux. Je suis très attentif à cela quand j’écris. C’est même souvent le point de départ d’un texte. J’ai par exemple commencé L’Île d’elles, mon premier roman pour adultes, sur la seule envie de faire éprouver au lecteur comment la chaleur peut en même temps nous accabler et nous enflammer. Je n’avais alors aucune idée de l’histoire que j’allais raconter, mais tout a découlé de cette volonté : les personnages, les scènes, et même le style.
Après, depuis ma lecture de Sur la route plus jeune, je suis également très sensible aux textes qui ont une vraie musicalité. Plus qu’une idée, une histoire ou une façon de construire une phrase, c’est quelque chose que je peux tenter de capter dans un roman pour l’adapter à mon propre travail.
Sinon, j’ai — comme beaucoup d’auteurs, je crois — eu longtemps du mal à lire pendant que j’écrivais. Mais aujourd’hui, c’est tout le contraire. J’en ai besoin, et j’aime être plongé dans des textes à la musicalité très différente de mon travail du moment. Non par peur d’être influencé — on l’est tous et je ne crois pas que la valeur d’un roman soit liée à son originalité —, mais dans l’espoir que quelque chose d’enthousiasmant naisse de cette confrontation.
Quelles lectures ont accompagné l’écriture de L’île d’elles ?
Romuald Giulivo : C’est une écriture qui a duré plusieurs années, donc les textes qui l’ont accompagnée ont été nombreux. Il y avait d’abord des souvenirs de lectures, plus que des lectures en elles-mêmes. En premier lieu des romans de Philippe Djian, à l’époque où il a quitté Bernard Barrault pour Gallimard. Des textes comme Lent dehors ou Sotos demeurent pour moi ce qu’il a fait de mieux.
Sinon, L’île d’elles c’est l’histoire d’une mère et de son fils qui attendent le retour du père. Autant dire que L’Odyssée, que j’ai lue alors plusieurs fois et dans plusieurs traductions, a été évidemment été très présente. Enfin, à force de fréquenter depuis un bon moment des auteurs comme Claude Simon ou Herman Broch, c’est-à-dire des écrivains capables d’écrire des phrases très amples où la temporalité est brouillée, ça m’a donné envie d’essayer. Jusqu’ici mon écriture était plus sèche, plus épurée, elle devait beaucoup aux nouvelles de Raymond Carver, mais j’avais besoin d’injecter quelque chose de nouveau, de prendre le contre-pied des habitudes, pour y revenir autrement plus tard, qui sait. Je crois qu’il est important de ne jamais se fier à des certitudes dans la lecture. D’à la fois continuer à faire des découvertes, mais aussi de s’entraîner à poser un regard nouveau sur certains livres déjà dans notre bibliothèque. Ainsi, pour un projet de roman graphique un peu dingue, j’ai dû relire entièrement Lovecraft, ce que je n’avais pas fait depuis l’âge de 16 ans. Et j’ai été surpris de le voir autrement, de bien plus m’attarder sur ses intentions littéraires. Je l’ai vraiment redécouvert. Ses livres n’ont pas changé, c’est moi qui ai changé et je trouve intéressant de se confronter à ça. Certains livres, comme À la recherche du temps perdu évidemment, semblent avoir presque été écrits rien que pour ça.
Quel serait le livre dont tu aimerais parler ?
Romuald Giulivo : L’un des livres qui m’a le plus parlé ces dernières années, c’est Extinction de Thomas Bernhard. Après le confinement, j’avais une vraie colère contre la parole médiatique et politique. Ça m’a aidé à faire avec… en plus, ça m’a donné l’idée et l’envie d’écrire un texte que je viens de boucler. Je me suis sinon relancé dans une énième tentative de lecture de Proust et, cette fois, je suis presque au bout. Ce que j’aime avec Proust, c’est l’impossibilité d’en parler justement. L’exercice devient vite ennuyeux ou pompeux. Je trouve fantastique qu’un texte résiste comme ça, qu’il ne puisse exister que dans une approche intime. Quand bien même La Recherche est l’un des romans sur lesquels on a le plus écrit, la seule façon de savoir vraiment de quoi ça cause, c’est de le lire.
Comment choisis-tu tes livres ?
Romuald Giulivo : J’avoue ne pas être très sensible aux conseils de lecture, que ce soit des gens qui m’entourent ou des médias. Mon meilleur conseiller littéraire reste le hasard, peut-être parce que je suis un vrai amoureux des bouquinistes et qu’on ne sait jamais trop ce que l’on va pouvoir trouver dans leurs bacs. J’aime aussi l’idée que ce n’est pas nous qui trouvons un livre, mais plutôt l’inverse parfois. Je demeure quand même assez monomaniaque, et ce n’est donc pas rare que, si un auteur me plaît, j’explore la totalité de son œuvre. Et puis j’aime aussi me laisser porter par des critères moins rationnels, comme la qualité d’un papier, la poésie d’un titre ou la couleur d’une couverture.
Quel est ton souhait d’écrivain ?
Romuald Giulivo : Être un écrivain heureux. Ça serait déjà pas mal par les temps qui courent, non ?
Romuald Giulivo consacre son temps à la littérature et à la musique expérimentale, quelque part sur les bords de la Garonne.
Bibliographie sélective de Romuald Giulivo :
Le Dernier Jour de Howard Phillips Lovecraft, 404 Comics
L’Île d’elles, Anne Carrière
Sans un mot, École des Loisirs
Pour en savoir plus :